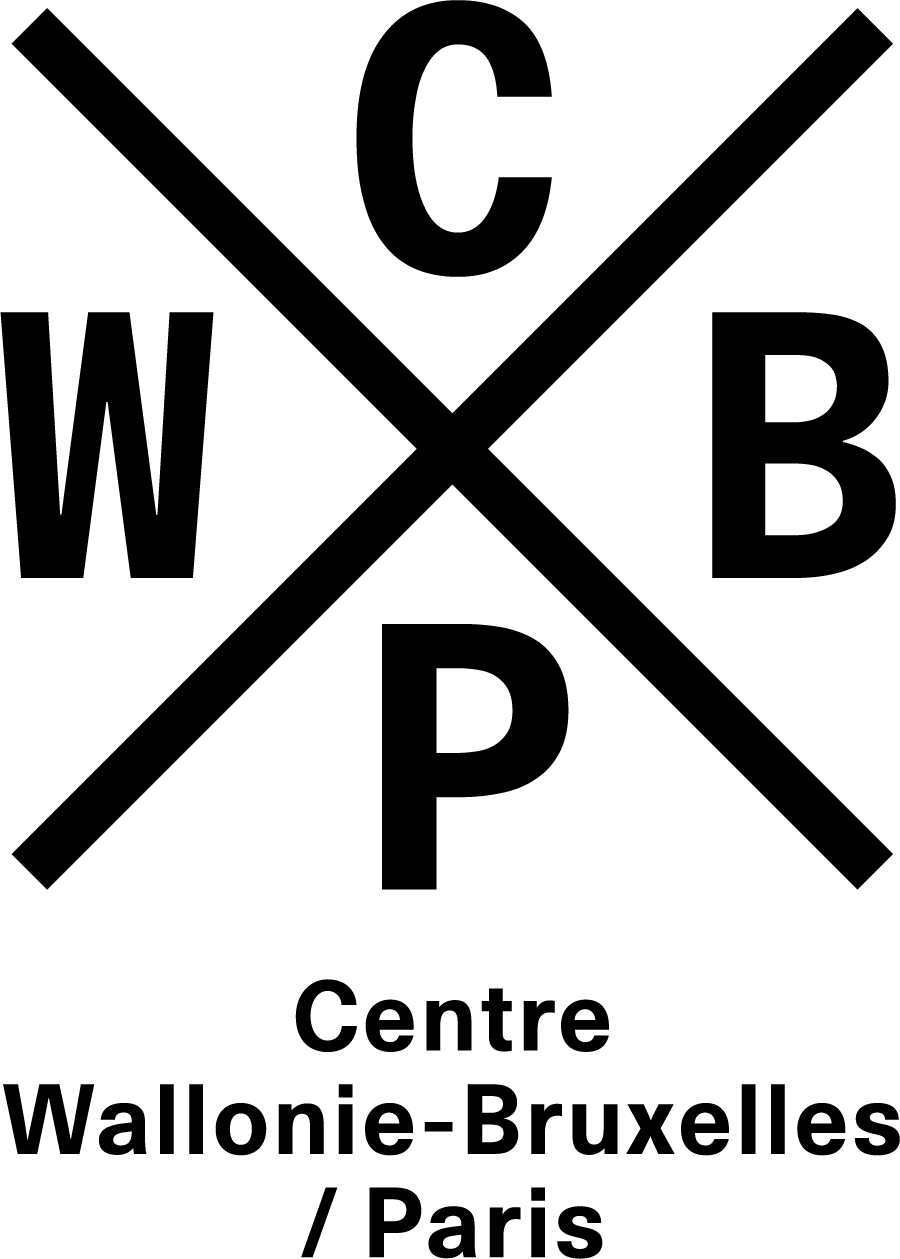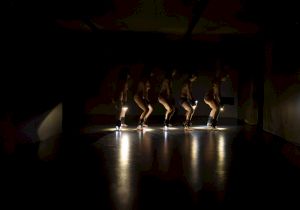Performissima 2025
Merci de sélectionner uniquement votre créneau d’arrivée.
L’entrée est garantie pendant ± 30 minutes autour de ce créneau.
À l’accueil, un bracelet sera distribué, permettant d’entrer et sortir librement des espaces du festival.
Le billet donne accès à toute la programmation du Festival PERFORMISSIMA, au CWB Paris et au Centre Culturel de Serbie, à partir du créneau choisi.
NB À partir de 21h, l’accès à la soirée en théâtre se fera dans la limite des places disponibles.
Le Centre Wallonie Bruxelles lance à nouveau avec Performissima une invitation transnationale à fêter la performativité sous toutes ses formes.
Cette seconde édition, imaginée comme un appel à l’extravagance kinesthésique, visuelle et sonore se tiendra de midi à minuit, en In-Situ & en Hors-Les-Murs. Aux côtés d’une trentaine d’artistes installé·e·s à Bruxelles et en Wallonie, trente artistes internationaux·ales issu·e·s de 24 pays se réunissent pour explorer de nouvelles formes, dire, faire et agir autrement.
Côté suisse : Emma Saba avec Jeanne Pâris, Léa Katharina Meier avec Tatiana Baumgartner, Sofia Kouloukouri, Tiran Willemse, et Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė avec Anna Marchenko.
Emma Saba, 'Jalousie des tempêtes !!'
Horaires de passage :
Entre 19:00 et 19:30
Entre 23:00 et 23:30
Jalousie des tempêtes !! est une réactivation très infidèle.
En collaboration avec lae chanteureusex Jeanne Pâris / Jano, Emma Saba hante le répertoire lyrique classique des fantômes du présent. Et vice versa.
Dans un jeu d’ubiquité historique des corps et des voix, iels se mêlent dans une relation qui est un voyage — entre tentative de fusion et désillusion d’appartenance.
éléments biographiques
Emma danse et organise des danses.Elle collabore avec Collettivo Cinetico, Clara Delorme, Cosima Grand, Marlène Charpentier, Marie Jeger, entre autres.
En 2022, son solo la fine di tutte le cose / l’inizio di tutte le altre est créé au Pavillon ADC à Genève, puis présenté au Festival Artdanthé (Paris), au Roxy Birsfelden (Bâle), au Festival GOGOGO (Genève), ainsi qu’au Festival Sol Invictus à l’Istituto Svizzero (Rome et Palerme).
Elle fait partie du collectif foulles, avec lequel elle a créé les pièces Medieval crack et Le cerveau mou de l’existence, ainsi que plusieurs performances in situ et installations.
En 2024–2025, elle est artiste en résidence à la Cité internationale des arts à Paris, et soutenue par le réseau européen Grand-Luxe, ce qui l’amène à partager son travail en résidence lors des Open Days à Onassis Stegi (Athènes), des Open Studios à Campus / Festival Dias de Dança (Porto), à Grand Studio (Bruxelles), Theater Freiburg (Freiburg) et Pôle Sud (Strasbourg).
Sa prochaine pièce (PREMIO 2025) sera présentée en mars 2026 au Pavillon ADC (Genève), puis à La Grange (Lausanne) et au Roxy Birsfelden (Bâle).
Après une formation musicale au Conservatoire de Bologne, elle termine ses études à La Manufacture (Lausanne) en 2021, puis devient artiste associée à L’Abri – Genève.
Depuis 2018, Emma développe des pratiques de danse, chant et d’autohypnose pour réactiver ubiquitairement son héritage musical classique. Dans le désir de tracer une archéologie féministe du spectaculaire, elle s’intéresse à l’opéra, à la médiumnité et au travail domestique, entre autres.
Léa Katharina Meier, 'Le fabuleux destin de Monsieur Della Merde'
Horaires de passage :
Entre 15:30 et 16:00
Entre 19:00 et 19:30
Léa Katharina Meier, en collaboration avec Tatiana Baumgartner, propose un solo centré sur un élément récurrent de sa pratique artistique : le storytelling.
Dans Le fabuleux destin de Monsieur Della Merde, son alter ego clownesque, Monsieur Della Merde, vient raconter une série de petites histoires qui ont marqué son fabuleux destin. Entre logorrhée, comptine enfantine, victime et bourreau, tour de magie, prise d’otage, crise d’hystérie et chanson paillarde, ce personnage oscillant saura tour à tour séduire, effrayer et attendrir.
Le fabuleux destin de Monsieur Della Merde est un extrait solo de la pièce collective Terminale Hysteria, conçue et mise-en-scène par Tatiana Baumgartner et Léa Katharina Meier
éléments biographiques
Léa Katharina Meier (née en 1989 en Suisse) est une artiste scénique et visuelle. Utilisant le clown comme pratique performative, sa recherche se concentre sur les notions de ridicule, d’abjection et de jubilation afin de créer un univers visuel et sensoriel qui embrasse le public. A partir de ses échecs intimes, elle souhaite développer un humour et une poésie lesbienne et sale. Sur scène, elle s’attache à incarner des émotions définies comme négatives comme une source de plaisir. Le conte, le corps comme archive, la féminité grotesque, la honte ainsi qu’un univers aux caractères enfantins sont des motifs récurrents au sein de sa pratique. Léa Katharina Meier a montré son travail dans de nombreux espaces d’art et théâtres en Suisse, en Italie et au Brésil (Arsenic, Tunnel Tunnel, MCBA, TU-Théâtre de l’Usine, Lateral Roma, Istituto Svizzero, Pivô arte e pesquisa). En 2021, elle reçoit le Prix suisse de la performance pour “Tous les sexes tombent du ciel”. En 2023, elle fait partie de l’exposition des Swiss Art Awards à Bâle. Elle a été résidente de l’Institut suisse de Rome en 23-24 et a récemment reçu le prix de la Fondation Irène Reymond à Lausanne. En 2025, elle montrera son travail scénique au sein de la Sélection Suisse en Avignon ainsi que de Performissima à Paris.
“Je suis une artiste visuelle, performeuse et metteuse-en-scène. Au sein de ma pratique, je m’intéresse à la thématique du ridicule, du malaise et de l’abjection et à comment ces sentiments peuvent être réinvestis avec humour et bienveillance dans une perspective de rire et de guérison. En développant une langue propre à mon travail, je souhaite constituer une poésie sale et lesbienne. Le livre, la bibliothèque, les archives, la mémoire, le storytelling et la construction d’un univers esthétique aux caractéristiques enfantines sont également des motifs récurrents dans mes travaux. Depuis plusieurs années, la théorie des affects et plus particulièrement la question de la honte occupent une place centrale dans ma pratique. Je l’aborde dans une perspective intime, corporelle, collective et politique. Je souhaite poser un regard critique et amusé sur les structures autoritaires, telles que les archives, la famille, l’école, l’hétérosexualité ou encore la langue, qui polissent nos mémoires, nos savoirs, nos désirs et nos sexualités. En opposition à l’humour normatif qui perpétue des mécanismes oppressifs, j’utilise la pratique du clown comme stratégie de création de rire et d’imaginaires alternatifs et pédéexs.” - Léa Katharina Meier
Crédits
Concept, collaboration artistique et mise-en-scène: Léa Katharina Meier et Tatiana Baumgartner
Performance, texte et visuels: Léa Katharina Meier
Costume: Safia Semlali
Production, administration et diffusion: Artemisia Romano
Equipe de création et de production de « Terminale Hysteria »: Tatiana Baumgartner, Léa Katharina Meier, Maria-Fernanda Ordonnez Pinzon, Dominique Gilliot, Adina Secretan, Vicky Althaus, Charlotte Carteret, Guits, Redwan Reys, Nayansaku Mufwankolo, Safia Semlali, Artemisia Romano
Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė, 'Brood (Scène 4) : Possession Undone'
Horaires de passage :
Entre 18:30 et 19:30
Brood (Scène 4) : Possession Undone réinvente le passage de possession du personnage d’Anna/Helen, interprété par Isabelle Adjani dans le film Possession (1981) d’Andrzej Żuławski. Diffusée en direct depuis le passage souterrain et les coulisses du CWB, la performance in situ de la performeuse Anna Marchenko met en scène la déconstruction de ce moment cinématographique emblématique, prolongé dans la durée et réexaminé par l’artiste en temps réel. Le public n’en perçoit que l’expérience médiatisée.
Brood (Scène 4) : Possession Undone est une nouvelle création développée à partir de la quatrième scène de la performance BROOD, d’une durée de six heures, commandée par le Centre Pompidou à Paris pour Move 2023.
La performance s’articule autour du thème du double, central à la fois dans le film de Żuławski — notamment dans la construction du personnage incarné par Adjani — et dans la pratique récurrente de Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė. La série de performances et de vidéos BROOD explore les imposteur·es, les jumeaux/jumelles, les profils sur les réseaux sociaux et les fantômes : une présence simultanée de soi et de l’autre, convoquant les doppelgängers, ces miroirs indésirables qui renvoient des versions distordues et troublantes du moi.
Ce motif culturel récurrent prend une signification nouvelle à mesure que les traditions populaires se mêlent aux technologies émergentes. Le double fracture la vision, remet en question les notions figées de l’identité et prend une nouvelle forme à travers notre « second moi numérique », tel que le décrit Daisy Hildyard — une présence à la fois réelle et distante, qui façonne nos interactions de manière invisible.
élements biographiques
Dorota Gawęda (PL/CH) et Eglė Kulbokaitė (LT/CH) sont toutes deux diplômées du Royal College of Art de Londres. Elles travaillent dans une pluralité de médiums : performance, peinture, sculpture, fragrance, vidéo et installation – là où le langage se défait et où un genre se transforme en plusieurs. Elles ont exposé à l’international, notamment à la Renaissance Society de Chicago, chez Thaddaeus Ropac à Paris, au Centre Georges-Pompidou à Paris, à la Biennale de Vilnius, à la Kunsthalle Mainz, au Kunstverein Hamburg, à l’Istituto Svizzero de Palerme et Milan, au Swiss Institute de New York, à la Julia Stoschek Collection de Düsseldorf, à la Kunsthalle Fribourg, à Lafayette Anticipations à Paris, au Palais de Tokyo à Paris, à la Biennale d’Athènes, à la Kunsthalle Basel, à l’ICA de Londres, au Museum of Modern Art de Varsovie, entre autres. Elles sont les fondatrices du YOUNG GIRL READING GROUP (2013–2021), lauréates de l’Allegro Artist Prize 2022, de la résidence CERN Collide 2022, ainsi que du Swiss Performance Art Award 2021. Actuellement en résidence à la Cité des Arts à Paris, elles préparent une exposition personnelle au MACA, Beijing, prévue pour l’automne 2025.
Dorota Gawęda et Eglė Kulbokaitė travaillent dans une pluralité de médiums – performance, peinture, sculpture, fragrance, vidéo et installation – là où le langage se défait et où un genre se transforme en plusieurs. En transmettant et croisant différents corps de savoirs à travers l’espace et le temps, elles développent une pratique fondée sur la recherche, qui tisse ensemble des champs apparemment disparates : écologie et technologie, science et magie, intelligence non-humaine et spéculation partagée. Les artistes explorent actuellement le motif du double à travers la culture populaire, l’art, le folklore et la technologie, afin de démêler les fils de l’identité contemporaine, en interrogeant les frontières du soi dans un monde où le réel et le virtuel sont de plus en plus imbriqués et brouillés.
Sofia Kouloukouri, 'ELECTRIC WRATH'
Horaires de passage :
Entre 17:30 et 18:00
Entre 21:00 et 21:30
ELECTRIC WRATH est une performance dansée qui explore la force collective des femmes et leur visibilité en tant que corps uni. Expérience au-delà des mots, elle met en scène la colère féminine et son impact. Un dispositif porté à la main transforme l’énergie cinétique des interprètes en électricité, rendant leur présence tangible. L’intensité et la répétition plongent le corps collectif dans une transe de fureur.
La pièce traduit un état émotionnel en force élémentaire. Elle questionne ainsi l’autosuffisance énergétique : l’impact environnemental d’une pratique artistique devient crucial, même en performance, et ELECTRIC WRATH met la colère féminine au service de cette énergie. La pièce constitue aussi un entraînement physique, une recherche d’équilibre vivant et collectif, explorant la dynamique de groupe et ses possibilités de puissance et d’action partagée.
élements biographiques
SOFI KORI (nom de scène de Sofia Kouloukouri) est artiste visuelle, performeuse, écrivaine et historienne de l’art. Dans son travail, les corps féminins affrontent des poids réels et affectifs, explorant physiquement ce que signifie être solide en tant que femme aujourd’hui. KORI est titulaire d’une licence et d’un master en études cinématographiques (AUTH, Thessalonique), d’un master en arts visuels (Edhea, Sierre) et d’un master en histoire de l’art (UNIGE, Genève). Ses recherches académiques portent sur les femmes, l’art, le sexe et l’agentivité. Ses textes ont été publiés par Nero Editions, Miami Books et The Art Newspaper. Son premier livre Artistes femmes et travail du sexe est paru chez L’Harmattan en mars 2025. Le travail de KORI a été présenté, entre autres, à : Roman Road Londres, Théâtre du Grütli Genève, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires (MACBA), Musée cantonal des Beaux-Arts Lausanne (MCBA), Palais de Rumine Lausanne, MIR festival, Kunsthal Charlottenborg Copenhague, Roma Diffusa, Phenomenon Studios Reykjavik, ArtAthina, Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. En 2024, elle a participé à ORGANISMO, programme de recherche de TBA21 sur l’art et les écologies appliquées critiques. Elle est actuellement en résidence à la Cité internationale des Arts à Paris.
À travers l’endurance et la narration, le travail de SOFI KORI interroge les poids réels et affectifs comme héritage féminin, issu de l’éducation des filles, des mythes et des doctrines religieuses. Ses performances prennent la forme de solos narratifs ou de performances physiques proches de l’entraînement.
Crédits
Créée à Buenos Aires, ELECTRIC WRATH a été présentée pour la première fois au Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires (MACBA), puis à l’Espace Movaq en 2022. Une nouvelle version a été co-produite et présentée au MIR Festival à Athènes en 2023, puis à l’espace M54 à Athènes et au Roma Diffusa Festival en 2024. Les interprètes de ELECTRIC WRATH se font appeler les RE-SISTERS.
Tiran Willemse, 'blackmilk'
Horaires de passage :
Entre 17:30 et 18:00
Entre 22:00 et 22:30
blackmilk est la première partie de la trilogie des Trompoppies de Tiran Willemse. Issue de l’Afrikaans, Trompoppies renvoie aux majorettes en uniforme accompagnées de leur tambour. La performance examine les gestes des mains de ces danseur.euse.s de formation. En fusionnant les mouvements des majorettes avec les gestes mélodramatiques de starlettes blanches, ainsi que les gestes associés aux stars masculines noires du rap, l’oeuvre explore la représentation des corps présentés comme masculins, africains et afro-américains. blackmilk intervient dans ce répertoire limité des représentations en utilisant les moyens de la performance.
éléments biographiques
Tiran Willemse, danseur, chorégraphe et chercheur sud-africain basé à Zürich, a d’abord étudié le ballet en Afrique du Sud et en Europe avant d’intégrer P.A.R.T.S à Bruxelles, et la Haute école des arts de Bern (HKB). Sa pratique, fondée sur la performance, est ancrée dans une attention particulière à l’espace, à l’imagination, au geste et au son, en se concentrant sur la manière dont ils sont liés aux constructions de la race, du genre et de la mémoire. Tiran a travaillé et collaboré avec les chorégraphes Trajal Harrell, Jérôme Bel, Wu-Tsang, Ligia Lewis, Meg Stuart, Andros Zins-Browne, Eszter Salamon et Deborah Hay. En 2022, il remporte le Prix Suisse de la Performance.
Crédits
Concept, Artistic Direction & Performance: Tiran Willemse
Light design: Fudetani Ryoya
Music: Manuel Riegler
Costume: LML studio Berlin
Production: Paelden Tamnyen, Rabea Grand
Touring/Production: Eva Cabañas
Distribution: Tristan Barani
Co-production: Sophiensaele Berlin, Tanzquartier Wien, Gessnerallee Zürich, WP Zimmer Antwerp
Residency support: Tanzhaus Zurich, Buda Kortrijk, Les Urbaines Lausanne, Impulstanz Vienna, Trauma Bar and Kino Berlin